
O que é uma quase-lua? Descoberta de 2025 PN7 e outros companheiros da Terra
Dans le ciel nocturne, la Terre partage parfois ses pas avec des visiteurs qui ne s’accrochent pas à elle comme une lune traditionnelle, mais qui flânent autour du Soleil en compagnie de notre planète. On les appelle des quasi‑lunes. Pour un observateur sur Terre, elles donnent l’impression de « danser » autour de nous, sans être gravitationnellement captives. Cette catégorie d’objets est fascinante car elle révèle les subtilités des trajectoires célestes dans le ballet du système solaire.
Qu’est‑ce qu’une quasi‑lune ?
Une quasi‑lune est un astéroïde qui partage l’orbite de la Terre autour du Soleil, mais sans être géostationnaire ou gravitationnellement lié à la planète. En termes simples, son orbite autour du Soleil est proche de celle de la Terre, de sorte que sa période orbitale est très proche de 1 année. Or, contrairement à un satellite artificiel ou naturel classique, la gravitation terrestre n’exerce pas une capture qui l’emprisonne autour de la Terre.
Ce qui distingue une quasi‑lune d’un satellite naturel classique, c’est la façon dont elle « tourne » autour du Soleil et la manière dont elle se manifeste depuis la Terre. Un satellite classique est lié à la Terre par sa propre orbite autour de celle‑ci et suit un chemin autour de notre planète. Une quasi‑lune, en revanche, évolue autour du Soleil dans une orbite proche de celle de la Terre et n’a pas d’énergie orbitale négative par rapport à la Terre. Son rapport avec la Terre est donc temporaire et dynamique, sans capture permanente.
Trajectoires coorbitales et la particularité des quasi‑lunes
Le phénomène est un exemple d’orbite résolument trois corps, où la gravité de la Terre et du Soleil, et parfois d’autres planètes, façonnent le chemin de l’astéroïde. Les quasi‑lunes appartiennent souvent à une catégorie appelée résonance 1:1, où la période orbitale de l’objet autour du Soleil est presque égale à celle de la Terre. Selon la configuration, on peut observer différentes sortes de trajectoires coorbitales : les « exercices de style » vont du grand détour autour du Soleil à des flux qui, vus depuis la Terre, donnent l’impression que l’objet tourne autour de nous.
Une quasi‑lune se déplace donc en une orbite solaire mais, dans notre référentiel terrestre, elle paraît se rapprocher et s’éloigner, restant près de la Terre pendant des années, parfois des décennies. Cette impression est renforcée par le fait que, pendant une partie de son parcours, l’astre passera devant ou derrière le Soleil par rapport à nous, puis réapparaîtra dans le ciel nocturne comme s’il « suivait » la Terre. C’est ce type burlesque de danse gravitationnelle qui a valu le nom de quasi‑lune.
2025 PN7 : une quasi‑lune actuelle et son histoire sur l’orbite terrestre
La quasi‑lune baptisée 2025 PN7 a été découverte le 29 août 2025 par le télescope Pan‑STARRS, au Mauna Kea, à Hawaï. Cette petite astéroïde partage l’orbite terrestre autour du Soleil depuis environ six décennies et, selon les modélisations actuelles, y restera encore environ six décennies. Autrement dit, PN7 est un compagnon solaire du destin terrestre qui, durant toute une génération, évolue presque comme une jumelle orbitale. Cette situation particulière met en évidence que des corps minuscules peuvent rester coorbitales avec la Terre pendant de longues périodes sans être accrochés par la gravité terrestre.
Sur le plan dynamique, PN7 suit une orbite solaire dont le demi‑grand axe est très proche de celui de la Terre, ce qui donne une période d’environ un an. Toutefois, sa trajectoire n’est pas une simple répétition. Au fil des années, PN7 peut apparaître dans le ciel nocturne près de l’Earth comme une étoile filante lente, puis s’éloigner et revenir. Ce comportement est typique des quasi‑lunes et offre une belle fenêtre d’observation pour les astronomes amateurs et professionnels.
Kamoʻoalewa, Cardea et le panorama des quasi‑lunes
Parmi les quasi‑lunes les plus connus figure Kamoʻoalewa, parfois surnommée la « lune artificielle » mais bien plus proche d’un astéroïde coorbital. Kamoʻoalewa est une quasi‑lune qui partage aussi l’orbite terrestre autour du Soleil, exhibant une stabilité remarquable sur des échelles de temps allant de plusieurs décennies à des siècles. Sa trajectoire est plus ou moins proche de celle de la Terre, ce qui fait qu’elle demeure visible sur des périodes répétées et offre un laboratoire naturel pour étudier les mécanismes de résonance 1:1.
Cardea est un autre quasi‑satellite terrestre, découvert plus récemment, qui illustre la variété des trajectoires coorbitales possibles. Comme PN7 et Kamoʻoalewa, Cardea évolue dans une orbite solaire proche de celle de la Terre et peut être observé comme un compagnon éphémère dans le ciel nocturne pendant des années. Ces objets démontrent que notre planète n’est pas seule dans son voisinage cosmique : elle partage son chemin autour du Soleil avec des voyageurs minuscules et longtemps discrets.
Une mission qui regarde Kamoʻoalewa de près : Tianwen‑2
En 2025, la Chine a lancé la mission Tianwen‑2, avec l’objectif ambitieux de rapporter des échantillons de Kamoʻoalewa. L’idée est double : comprendre l’origine et la composition des quasi‑lunes, et enrichir notre connaissance des échanges matière entre les corps du système solaire. Si Tianwen‑2 touche sa cible, nous disposerons d’analyses directes et d’une meilleure compréhension de la dynamique des objets coorbitales. Cette exploration souligne aussi l’intérêt stratégique de suivre ces voyageurs du Soleil pour mieux appréhender leur distribution et leur longévité autour de la Terre.
Ce que nous apprennent les quasi‑lunes
Les quasi‑lunes, dont PN7 illustre parfaitement le caractère éphémère mais stable, montrent que l’espace qui nous entoure recèle des voisins minuscules mais crédibles, qui ne suivent pas les règles simples des grandes lunes. Leur étude éclaire plusieurs domaines : les mécanismes de résonance gravitationnelle, les échanges d’énergies dans le champ solaire, et les conditions qui permettent à un petit corps d’évoluer à proximité de la Terre sans être définitivement capturé. Elles nous rappellent aussi que les frontières entre « ici » et « là‑bas » dans notre propre voisinage orbital restent floues et dynamiques.
Conclusion : regarder le ciel avec curiosité
La découverte de 2025 PN7 et l’observation continue de Kamoʻoalewa et Cardea nous invitent à prolonger notre regard sur le ciel. Des objets qui partagent notre orbite mais qui ne nous appartiennent pas — et qui restent près de nous pendant des décennies — témoignent de la richesse des dynamiques du système solaire. En poursuivant ces études, nous construisons une image plus complète de la façon dont les petits corps se déplacent, interagissent, et parfois se transforment en compagnons de route du Soleil. Alors que Tianwen‑2 ouvre la porte à des échantillons tirés de Kamoʻoalewa, l’exploration des quasi‑lunes rappelle que la curiosité humaine peut transformer une curiosité en connaissance tangible. Si vous avez aimé cette exploration des quasi‑lunes, d’autres sujets sur leur danse autour de la Terre vous attendent dans nos prochaines publications.

 Tudo
Tudo
 Dobson
Dobson
 Réfractores
Réfractores
 Ed & Apochromates
Ed & Apochromates
 Réflecteur Newton
Réflecteur Newton
 Schmidt Cassegrain
Schmidt Cassegrain
 Maksutov-Cassegrain
Maksutov-Cassegrain
 Solaire
Solaire
 Chercheur
Chercheur
 Réducteur de focale
Réducteur de focale
 Inteligente
Inteligente
 Tudo
Tudo
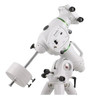 Equatorial
Equatorial
 Alt/Az
Alt/Az
 Harmônico
Harmônico
 Trípodes
Trípodes
 Acessórios
Acessórios
 Tudo
Tudo
 Grande angular
Grande angular
 Oculares Zoom
Oculares Zoom
 Oculares reticuladas
Oculares reticuladas
 Barlow
Barlow
 Plössl
Plössl
 Binóculos
Binóculos
 Corrector atmosférico
Corrector atmosférico
 Tudo
Tudo
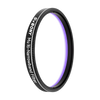 Visível
Visível
 Foto
Foto
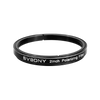 Polarisantes
Polarisantes
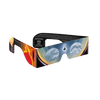 Filtres Solaire
Filtres Solaire
 Acessórios
Acessórios
 Tudo
Tudo
 Câmaras de cores
Câmaras de cores
 Câmaras monocromáticas
Câmaras monocromáticas
 Planétaire/guidage
Planétaire/guidage
 Objetivos
Objetivos
 Tudo
Tudo
 Binóculos
Binóculos
 Telescópio e Monocular
Telescópio e Monocular
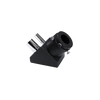 Renvois coudés
Renvois coudés
 Divisor óptico
Divisor óptico
 Espelhos
Espelhos
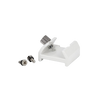 Tudo
Tudo
 Sacos e Proteções
Sacos e Proteções
 Supports e contrapesos
Supports e contrapesos
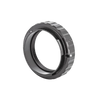 Adaptadores para câmera
Adaptadores para câmera
 Focuser
Focuser
 Colimação
Colimação
 Bande-chauffante
Bande-chauffante
 Câbles
Câbles
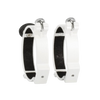 Colares
Colares
 Computadores
Computadores
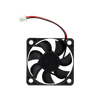 Ventiladores
Ventiladores
 Outros
Outros
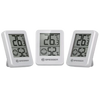 Tudo
Tudo
 Estação Meteorológica
Estação Meteorológica
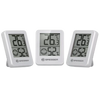 Termómetro
Termómetro
 Tudo
Tudo
 Observatório/Domos
Observatório/Domos
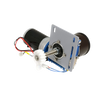 Acessórios
Acessórios
 Askar
Askar
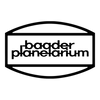 Baader
Baader
 Bresser
Bresser
 Celestron
Celestron
 Explore Scientific
Explore Scientific
 GSO
GSO
 Optolong
Optolong
 Touptek
Touptek
 Vixen
Vixen
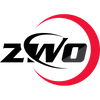 ZWO
ZWO